Ne pas se fier aux apparences… Avec sa forêt enchanteresse et ses personnages truculents, ces animaux dotés de la parole et son univers onirique, le roman est rédigé comme un conte pour enfants. Mais l’illusion s’estompe au fil des pages de cette longue saga nordique. En effet, l’humour se fait de plus en noir et les scènes de plus en plus violentes. Le sang et les larmes prennent le dessus sur le merveilleux dans cette Estonie du moyen âge, où le paganisme cède sa place au christianisme. Les personnages sont coincés entre l’enclume et le marteau : entre la nostalgie passéiste et fantasmée incarnée par une forêt en perdition d’un côté, et la modernité asservissante d’un village catholique en pleine expansion de l’autre. L’opposition entre identité fondée sur le terroir local et valeurs universelles globalisantes est au cœur du récit. L’auteur semble toutefois ne pas vouloir prendre parti entre le camp des forestiers cueilleurs-éleveurs et celui des villageois cultivateurs. Comme le rappelle la postface (rédigée par le traducteur du livre J.P. Minaudier) : « nous sommes toujours les modernes de quelqu’un, car toute tradition a un jour été une innovation ».
L’Estonie imaginaire et médiévale du roman regorge de points d’intérêt depuis un angle de vue géographique. Citons comme exemple le rôle joué par la lisière en tant qu’interface entre les deux mondes qui s’affrontent. Il résume toute l’ambivalence de la notion de frontière, lieu mouvant concentrant les antagonismes aussi bien que les échanges.
Si l’on devine que derrière la « modernité » décrite dans le livre se cache l’agressif État voisin Russe (et derrière la « forêt » le mythe d’une Estonie rurale et traditionnelle), le dilemme vécu par les héros, héroïnes et animaux de la forêt résonne avec des drames d’actualité. Songeons par exemple aux derniers représentants des peuples premiers amérindiens, parqués dans des réserves en Amérique du nord.
Ouvrage paru aux éditions Le Tripode en 2015.

 L'atelier
L'atelier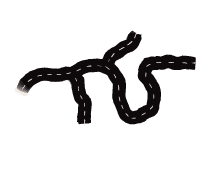 Les cartes
Les cartes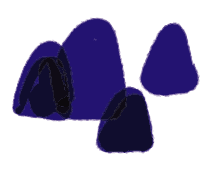 Les Objets
Les Objets Boutique
Boutique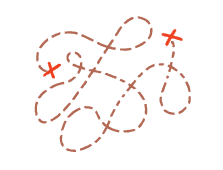 Infos
Infos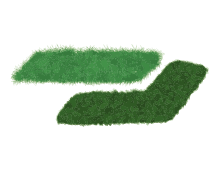 À propos
À propos